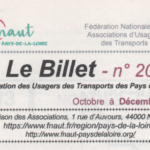Progrès dans les centres et le long des axes équipés
Les grandes villes de la Région ont bénéficié d’une continuité des politiques de mobilité qui a permis, dans la zone centrale, de réduire la circulation automobile et d’accroître celle des vélos et trottinettes, au bénéfice global de la santé et de la sécurité, moyennant quelques conflits très localisés. Les zones piétonnes ou apaisées se sont multipliées. Dans les zones périphériques, les habitants restent dépendants de la voiture.
L’attractivité du centre ville et des centres périphériques n’a pas baissé. La fréquentation les transports en commun (TC) a augmenté, grâce aux trams et aux lignes de bus améliorées, malgré des saturations ponctuelles et le ralentissement de la vitesse des bus. Ceci contribue à réduire les dépenses de déplacement des habitants.

Les lignes de bus restent à la base des réseaux dans la majorité des villes. Leur efficacité est liée à leur fréquence de passage et aux aménagements qui leur évitent les ralentissements dans les embouteillages
La gratuité, succès de fréquentation, a été mise en place dans quelques villes pour le WE. (Nantes, Laval, la Roche sur Yon). Au risque de retarder des investissements dans les TC, et de décourager des usagers payants sur les tronçons saturés (cas de Nantes). La gratuité n’entraînerait pas de report modal significatif depuis la voiture, qui s’est fait par contre depuis la marche et le vélo.
L’usage des TER périurbains a progressé, plus que l’offre, ce qui se traduit par des surcharges. La commande par la Région de nouveaux matériels tarde. Alors que les habitants de plus en plus nombreux du périurbain saturent les accès routiers, en l’absence d’une offre TC adaptée.

TER et tram-train, adaptés aux liaisons périurbaines, peuvent cohabiter
Développer les TC et modes actifs, dans toute l’aire urbaine
Pour continuer à réduire la pollution (gaz et particules fines) et les gaspillages liés à l’autosolisme, pour que tous les habitants aient droit à une offre mobilité autre que par la voiture et adaptée à leurs moyens, différentes mesures sont demandées par les usagers :
– développement des services de proximité, et répartition plus équilibrée de l’habitat, des services et activités. Les urbanisations sont à équiper d’axes de transports en commun et d’infrastructures piétons / vélos.
– réaffectation de l’espace public au profit de voies bus et voies vélos, de plantations. Le changement de comportement demande des contraintes à la circulation automobile : stationnement réduit, zones 30, Zone à Trafic Limité comme à Nantes, etc…
– poursuite de l’extension des liaisons transport en commun. Les projets d’extension de réseau de trams, comme récemment à Angers et bientôt à Nantes, de bus à haut niveau de service sur des axes protégés, comme à St Nazaire, Nantes et le Mans, disposant de la priorité aux carrefours, permettent et permettront un changement de modes de déplacement. Ces programmes sont à étendre, ou à entamer dans des villes telles Laval, la Roche-sur-Yon, Cholet.
– développement des modes actifs. Le vélo, utilisable jusqu’à la dizaine de km, doit disposer d’un réseau cohérent couvrant toute l’aire urbaine. La marche, doit être aussi sécurisée y compris hors zone piétonne.
– correspondances entre les différents réseaux, avec le développement des liaisons périphériques en tram et bus, de nouvelles gares périphériques, la connexion avec les axes vélos et piétons (aménagements, information, sécurisation vélo, …), pour offrir une alternative fiable à la voiture.

Les pôles de correspondance entre TER et réseau urbain sont la base d’un SERM / RER
– desserte du périurbain ( jusqu’à 50 km) dans un système de transport structuré autour des lignes ferroviaires et, en leur absence, de lignes de cars express, le tout cadencé et complété par des lignes périphériques. Or Région et grandes villes temporisent quant à la mise en place d’un SERM (Service Express Régional Métropolitain), ou RER à l’échelle des aires urbaines, qui demande une structure dédiée, un programme et des moyens, une tarification commune. La Région et les intercommunalités desservies doivent se regrouper, mettre leurs moyens en commun, avec ou sans statut SERM. Un programme coordonné entre autorités permettrait des économies, mais des recettes nouvelles sont également à mobiliser, en continuant à s’appuyer sur la participation des collectivités, des activités (versement mobilité), et des usagers.
– Attentif à leur environnement, les usagers veulent bien continuer à participer financièrement mais demandent :
-
une amélioration des capacités, et des fréquences des TC
-
un service élargi : des transports tôt le matin et tard le soir, y compris pour les trains, une offre permanente 365 j/an, consistante en WE
-
des trajets simplifiés, avec des liaisons diamétrales, plus de liaisons périphériques, des pôles de correspondance bien desservis, avec la mise à disposition de différents modes de transport, dont vélo, autopartage, etc…
-
une tarification intégrée tous modes, solidaire adaptée aux moyens de chacun, et couvrant toute l’aire urbaine, compatible avec la tarification régionale.
Ce sont les conditions pour donner consistance à une alternative à la voiture, en particulier dans les périphéries.